Zanskar: pont
suspendu en cordages (toutes les forces travaillent en traction). Simplicité
extrême, pauvreté de moyens.
Équilibre précaire.
Historique
|
Zanskar: pont
suspendu en cordages (toutes les forces travaillent en traction). Simplicité
extrême, pauvreté de moyens. |
|
L'origine des ponts suspendus, sous la forme de passerelles accrochées à des lianes►, est très lointaine. Ce n'est qu'au XVIIIème siècle, avec les barres et les fils en fer ou en acier, que naissent les premiers ponts suspendus►. Les méthodes de construction ainsi que le choix des matériaux utilisés étaient limités. Cependant, grâce à des techniques de plus en plus développées, les ingénieurs ont pu fabriquer des ponts toujours plus fiables.
Le premier pont suspendu en France fut réalisé par l'architecte et inventeur Marc Seguin en 1925, cette première réalisation fut brillante par son innovation. Son invention repose sur l'utilisation de câbles métalliques, de "faisceaux de fils de fer fin" sur de grands ouvrages, plus simples et deux fois plus résistants (au mm²) que les chaînes (à maillons) ou que les barres de fer. Marc Seguin proposa aussi une nouvelle façon de tresser les fils "en guirlande".
La construction de ces ponts suspendus fait aussi appel, pour la construction des piles, à des techniques nouvelles pour l'époque comme la bétonnière horizontale, les premiers embryons d'armatures métalliques internes au béton, la cloche à plongeur.
Un peu plus tard,
le
Français F. Arnodin invente le câble à torsion alternative, obtenu en enroulant
plusieurs couches de fils autour du premier fil rectiligne, les hélices étant
alternativement dans un sens et dans l'autre.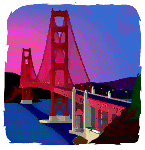
En 1931, la portée du George Washington Bridge dépasse pour la première fois les 1000m. C'est le premier grand pont suspendu moderne, mais il est moins connu que le ◄Golden Gate bridge►, qui lui ravit le record avec 1281 m.
Mais actuellement, les ponts suspendus ont perdu une grande partie de leur domaine d'emploi au profit des ouvrages à haubans, dont certains ont déjà été bâtis dès le début du XIXème siècle. Mais comme leurs tabliers étaient aussi insuffisants que ceux des ponts suspendus de l'époque, et qu'ils ne bénéficiaient pas de la rigidité apportée par les grands câbles porteurs, ils se sont très vite effondrés.
A la fin du XIXème siècle des haubans furent ajoutés sur certains ponts suspendus pour faciliter la construction et rigidifier en flexion longitudinale les zones proches des pylônes. En France, Gisdard développa un système extrêmement proche du haubanage direct qui fut repris pour la construction du pont de Lézardieux sur le Trieux en 1924.
Ce sont les ingénieurs allemands qui ont largement développé ce système de construction à partir de 1955, et l'ont amené à un haut degré de perfectionnement sous l'influence de Helmut Homberg et surtout de Fritz Leonhart.
La structure classique des ouvrages modernes est essentiellement constituée de câbles parallèles, qui sont les organes les plus caractéristiques des ponts suspendus, supportés par des pylônes et ancrés par des massifs extérieurs. (Le câble est économique car il utilise l'acier uniquement en traction, ce qui correspond le mieux aux qualités de ce matériau.)
Depuis le milieu du siècle dernier, nous assistons à une véritable surenchère concernant le dimensionnement des ouvrages à câbles porteurs paraboliques. Actuellement, les plus longues travées de ponts au monde sont toutes de type "suspension".